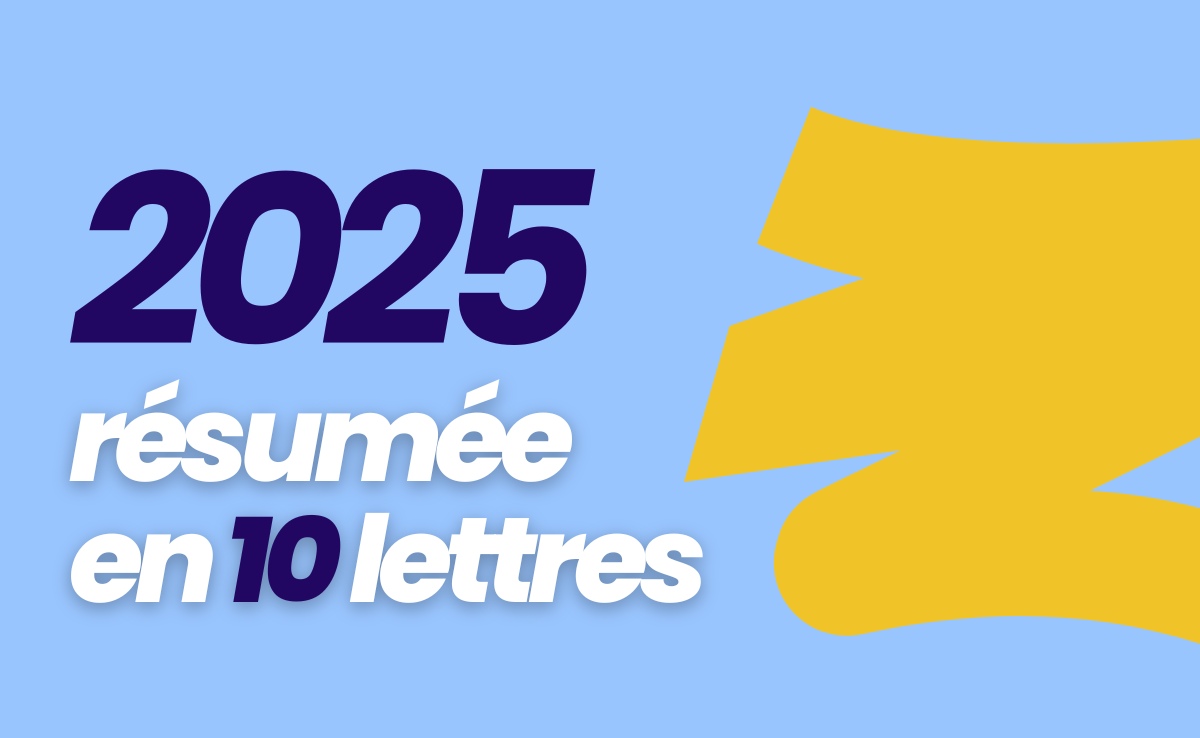Comment faire de la donnée un bien commun ?
Ce 7 octobre 2025 se tenait la première édition du Forum de la donnée territoriale, co-organisée par la FNCCR, la Direction interministérielle du numérique (DINUM), l’ANCT – Agence nationale de la cohésion des territoires et l’ IGN (Institut national de l’information géographique et forestière) en partenariat avec l’Avicca, Villes Internet, l’APVF, Villes de France, Déclic, OpenDataFrance, Les Interconnectés, l’Afigéo et le CNIG.
Si la donnée n’est pas un sujet nouveau, son utilisation par les collectivités territoriales est en pleine croissance. Les territoires explorent et exploitent le potentiel des données en matière de pilotage des politiques publiques. A l’heure où l’intelligence artificielle est un sujet prégnant, la donnée devient plus que jamais un matériau de première nécessité.
Ouvrir, faire circuler, protéger, rendre interopérable, autant de sujets abordés au cours des quatre tables rondes qui ont rythmé la journée. Et autant de sujets qui font plus que nous parler chez Numéricité !
Conjuguer données, territoires et politique publique
En ouverture de cette journée, Stéphanie Schaerrappelait les trois axes principaux de la feuille de route de la Direction Interministérielle du Numérique :
- Rendre les données visibles
- Faciliter leur circulation
- Faciliter l’accès et l’usage des données
Le défi est commun à l’Etat et aux collectivités : “il faut faire de la donnée un grand levier d’impact, de transparence et de confiance”.
Céline Colucci, présente à ce forum, nous parlait d’ailleurs de la relation entre les territoires et leurs données à travers de son expérience au sein des Interconnectés, l’association des collectivités dédiée aux enjeux numériques : https://numericite.eu/persons-of-internet-s04e04-data-et-territoires-quelle-maturite-des-collectivites-avec-celine-colucci/
1) Souveraineté numérique et maîtrise des données
Cette première table ronde a souligné les différentes facettes de la souveraineté en matière de données. Confidentialité, indépendance, stockage, accès, autant de paramètres à prendre en compte pour penser la maîtrise des données. Les enjeux opérationnels sont multiples : maîtriser où résident les données, qui y accède, sous quel droit elles sont traitées, et pouvoir en garantir la réversibilité. Elle ne se décrète pas : elle se construit techniquement, se gouverne politiquement et se finance collectivement. Concrètement : cartographier ses dépendances, imposer des clauses de portabilité et d’audit, s’appuyer sur des offres qualifiées et des alternatives européennes open sourcepour limiter les dépendances critiques.
A ce sujet, Samuel Goëta nous racontait comment l’open peut être un vecteur de transformation et d’innovation : https://numericite.eu/persons-of-internet-s04e05-quels-usages-et-quelles-perspectives-pour-lopen-data-avec-samuel-goeta/
La donnée est devenue une véritable ressource stratégique produite par une multitude d’acteurs et d’agents. Mise au service des politiques publiques, elle est devient également un bien commun. C’est la conviction que l’on porte en intervenant dans le cadre de missions comme DATAFID ou Data Governance in Africaoù les données sont au cœur de la transformation des métiers de la fiscalités et des douanes.
2) Mise en œuvre de la directive NIS2 et sécurité des données : le droit comme vecteur de partage des données
Le 1er octobre, l’ENISA, l’agence européenne de cybersécurité, révèle que le secteur public a concentré à lui seul 38,2% de l’ensemble des cyberattaques recensés dans l’Union européenne. Comment faire coopérer l’Etat et les collectivités en matière de prévention des risques ?
Dans ce contexte, la mise en œuvre de la directive NIS 2 – en français : sécurité des réseaux et des systèmes d’Information – “vise à renforcer le niveau de cybersécurité des tissus économique et administratif des pays membres de l’UE”. L’idée est de faire de la protection des données un outil pour tous, et de transformer cette législation en levier de confiance et d’action. La sécurité s’intègre dès la conception : cyber-by-design et RGPD-by-design au même niveau que l’UX. Faire du droit un levier de transformation des organisations, c’est l’approche portée par nos juristes dans leurs missions au quotidien.
La montée en compétences concerne autant les équipes techniques que les métiers et la mutualisation est décisive pour assurer la résilience des organisations. La cybersécurité relève aussi du management : arbitrages, priorisation, gouvernance lisible. Plus concrètement, il s’agit de déployer supervision, gestion des identités et des secrets, journaux, tests de restauration et plans de continuité. Les exercices de crise doivent être réguliers et suivis de retours d’expérience exploitables. L’objectif est de rendre la protection visible et mesurable, afin de sécuriser la circulation des données et d’oser ouvrir ce qui peut l’être sans mettre en danger les services.
3) La donnée, une aventure collective
Constance Nebbula le rappelait lors de son intervention, “la donnée n’est pas une aventure solitaire”. Comment construire des gouvernances partagées de la donnée ? L’objectif est simple éviter les silos reconstitués, fluidifier les coopérations et rendre chaque nouvelle donnée rejouable par d’autres. La gouvernance des données n’est pas une affaire de propriété, mais d’animation des interdépendances entre métiers, opérateurs et échelles territoriales. Elle repose sur une doctrine partagée qui clarifie responsabilités, niveaux d’accès, contrats d’usage et traçabilité.
Cela implique l’articulation de tous les niveaux : le national porte les référentiels, les socles et l’outillage coûteux ; le local priorise, forme, accompagne et met en service. Cecile Le Guen soulignait à juste titre qu’on ne peut pas éluder la question de la concertation et du dialogue entre les différents acteurs. La gouvernance des données n’est pas une affaire de propriété, mais d’animation des interdépendancesentre métiers, opérateurs et échelles territoriales.

Dans cet esprit, nous avons pu assister au lancement de la Fabrique de la donnée territoriale par Akim Oural Nicolas Berthelot et Marie-Agnès Scherrmann. Inventer des stratégies territoriales, les futures gouvernances locales, mettre en commun les forces pour accélérer la transformation numérique, autant d’enjeux dont va se saisir la Fabrique.
4) Utiliser les données pour étayer les politiques publiques
Pour ouvrir le dernier format de la journée, Simon Chignardposait cette question aux invités : peut-on, et doit-on faire de la donnée un levier d’action directe, et si oui quels seraient les leviers possibles ?

Une question qui n’est pas sans rejoindre celle de la gouvernance. Pour mettre la donnée au service des politiques publiques, il faut une approche collaborative et faciliter l’harmonisation et l’entraide entre l’État et les collectivités. La donnée révèle son plein potentiel quand elle sert la prise de décision et qu’elle contribue à la transformation des services.
Mesurer une politique publique suppose de ne pas réinventer les modèles de données à chaque projet, mais de capitaliser sur des schémas éprouvés. Cela implique aussi de collecter l’utile, c’est-à-dire ce qui éclaire la décision dans la durée, plutôt que d’accumuler des volumes inexploitables. L’ouverture reste une règle, mais avec discernement : cadres d’usage, filtrages, niveaux d’accès et protection explicite des données sensibles. Cette hygiène de données crée les conditions d’évaluations comparables, de coopérations fluides et d’innovations réplicables. Elle requiert enfin le courage de décider à partir des indicateurs – en explicitant les arbitrages. À l’ère de l’IA, elle oblige aussi à traiter la question de la valeur : comment nos données publiques alimentent-elles les modèles, et qui en bénéficie ?